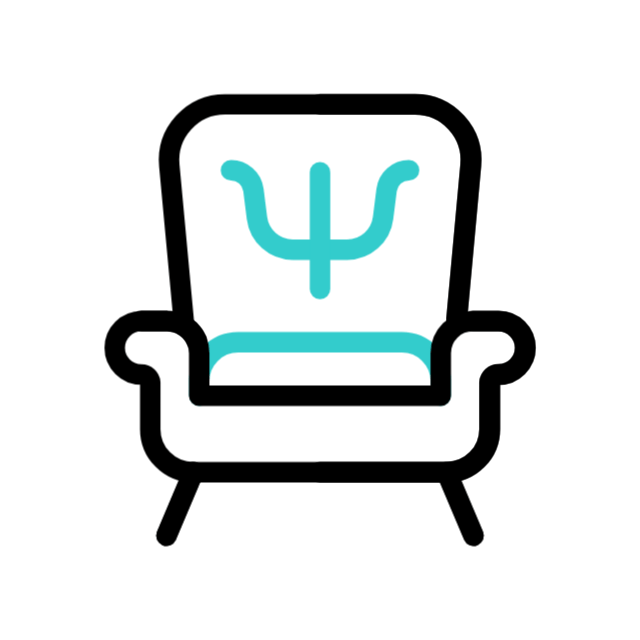Adaptation culturelle : mieux comprendre les différences
Vous est-il déjà arrivé de ne pas comprendre le comportement des autres, sans savoir pourquoi ? Ou d’être surpris par certaines attitudes, que ce soit lors d’un voyage ou dans votre vie quotidienne ? Ces différences ne sont pas le fruit du hasard : elles reflètent des cultures et des modes de fonctionnement sociaux distincts.
Dans un monde de plus en plus connecté, comprendre ces différences est essentiel pour mieux communiquer, éviter les malentendus et enrichir nos relations, qu’elles soient personnelles ou professionnelles. Chaque culture possède ses propres codes, habitudes et modes d’interaction, qui peuvent sembler déroutants si l’on n’en connaît pas les règles.
Cet article vous propose d’explorer plusieurs outils théoriques pour décrypter ces différences : les dimensions culturelles, la proxémie et la communication à haut et bas contexte. L’objectif est de vous offrir des clés pour observer et interpréter les comportements sociaux dans différents contextes, afin de vous adapter avec confiance et respect, et de transformer ces différences en véritables atouts dans vos échanges quotidiens.
Bonne lecture !
Hofstede – Théorie des dimensions culturelles
Geert Hofstede était un psychologue et sociologue néerlandais spécialisé dans les cultures et les comportements. Il a étudié comment les valeurs et les traditions influencent nos interactions dans différentes sociétés. Il est surtout connu pour avoir créé les dimensions culturelles, un outil pour mieux comprendre les différences entre pays et organisation.
Dans cette partie, je vais vous présenter les 6 dimensions culturelles d’Hofstede. En réalité, chacune de ces dimensions sont des mesures, mais je vais vous les présenter en terme de comportements qui peuvent être observé dans une culture en question.
1. La distance hiérarchique
La distance hiérarchique correspond à l’importance qu’accordent les membres d’une société à la distribution plus ou moins égale du pouvoir.
Dans les sociétés où la distance hiérarchique est forte, les autorités établissent clairement les rôles pour maintenir l’ordre. Les personnes acceptent les différences de pouvoir, et les employés suivent les consignes précises de leurs supérieurs. Les relations restent formelles entre personnes de statuts différents, avec un langage respectueux et des salutations codifiées. Même le style vestimentaire reflète la position sociale. Cette organisation valorise le respect et la clarté dans les échanges. Les citoyens respectent fortement les figures d’autorité et les experts, et ils remettent rarement en question leurs paroles.
À l’inverse, dans les sociétés à faible distance hiérarchique, les dirigeants ou les supérieurs cherchent la proximité avec les employés. Les citoyens posent librement des questions, discutent ou contestent certaines décisions. Le client négocie, donne son avis, et le vendeur adopte des interactions plus informelles. Les individus adaptent ou discutent les règles selon les besoins.
2. Individualisme vs Collectivisme
L’individualisme et le collectivisme correspondent à l’importance que donne la société à la personne face au groupe.
Dans une société individualiste, les personnes prennent principalement des décisions pour elles-mêmes assument la responsabilité de leurs choix. Chacun exprimer librement son avis, même s’il diverge du groupe. Les individus choisissent souvent leurs liens sociaux (amis, partenaires), et ils concentrent leur loyauté sur la famille proche. Les gens valorisent leur autonomie dans les activités communautaires et agissent seuls plutôt que de suivre la majorité. La société célèbre et encourage la réussite individuelle, et elle attribue les récompenses selon le mérite personnel.
À l’inverse, dans une société collectiviste les individus prennent des décisions en tenant compte des besoins et attentes du groupe (famille, communauté, équipe). Ils adaptent souvent leur comportement pour maintenir l’harmonie sociele ou éviter les conflits. Les liens sociaux s’étendent et se renforcent, incluant la famille élargie, les voisins et les membres de la communauté. La société valorise l’implication dans les activités collectives, et chacun contribue activement au bien-être commun. Les réussites sont partagées et célébrées au niveau du groupe plutôt qu’individuellement.
3. Masculinité vs Féminité
C’est la tendance d’une société à favoriser les valeurs dites « masculines » comme la compétition et la performance, par rapport aux valeurs dites « féminines » comme la coopération et le bien-être, ou inversement. Ces termes, je ne les inventent pas, ce sont ceux d’Hofstede.
Dans une société à forte « masculinité », la société valorise la compétition, l’ambition et le succès personnel ou collectif mesurable. Les rôles traditionnels restent souvent plus marqués (par exemple, attentes différentes selon le genre dans certains contextes). Les individus acceptent parfois les discussions et confrontations directes pour atteindre un objectif. La société encourage la performance, la réussite et le dépassement de soi dès le plus jeune âge. Les personnes affichent volontiers leurs réussitent et valorisent la force, l’efficacité ou le leadership.
Au contraire, dans une société à forte « féminité », la société valorise la coopération, l’entraide et le bien-être collectif. Les rôles deviennent plus flexibles et moins stéréotypés, avec une plus grande égalité entre genres. Les individus privilégient l’harmonie et le compromis pour résoudre les désaccords. La solidarité, le partage et le soutien mutuel sont encouragés dès l’enfance. Les personnes accordent de l’attention aux autres, pratiquent la tolérance et valorisent la coopération.
4. Aversion à l’incertitude
C’est la tolérance qu’une société manifeste face à l’ambiguïté ou au changement.
Dans une société marquée par une forte aversion pour l’incertitude, les individus suivent strictement les lois, les règles et les conventions pour éviter les situations imprévisibles. Ils prennent leurs décisions avec prudence et plannification, en cherchant à minimiser les risques. Ils perçoivent souvent les nouveautés ou les changements avec méfiance et peuvent les éviter. Leurs comportements restent plus codifiés et prévisibles, et ils recherchent la sécurité dans leurs relations. Les échanges se veulent clairs et explicites afin d’éviter les malentendus.
À l’inverse, dans une société qui exprime une faible aversion pour l’incertitude, les individus tolèrent plus facilement l’ambiguïté et adaptent ou remettent en question les règles. Ils acceptent de prendre des risques et improvisent face aux situations nouvelles. Ils accueillent positivement les nouveautés, encouragent l’expérimentation et favorise la créativité. Leurs comportements apparaissent plus flexibles et spontanés, leurs relations moins rigides. Ils considèrent les malentendus comme une partie normale de l’échange.
5. Orientation à long terme vs court terme
C’est la vision temporelle d’une culture. Elle peut privilégier une orientation à long terme, en favorisant l’innovation, ou une orientation à court terme, en s’appuyant sur ce qu’elle connaît déjà.
Dans une société tournée vers le long terme, les individus valorisent la planification, l’épargne et la préparation pour l’avenir. Ils mettent l’accent sur l’étude approfondie et la maîtrise progressive des compétences. Ils préviligient les liens durables et stables, avec un engagement à long terme dans les relations et la communauté. Ils choisissent des solutions réfléchies et durables plutôt que des actions rapides. Ils orientent leurs pratiquent et leurs efforts vers la réussite future plutôt que la gratification immédiate.
À l’inverse, dans une société tournée vers le court terme, les individus se concentrent sur les résultats immédiats et la satisfaction rapide. Ils privilégient les compétences pratiques et les gains rapides plutôt que l’apprentissage prolongé. Leurs relations apparaissent plus flexibles et adaptées aux besoins immédiats plutôt qu’aux engagements durables. Ils favorisent les solutions rapides et pragmatiques, même temporaires. Leurs coutumes et pratiques se centrent souvent sur le plaisir immédiat ou les bénéfices à court terme plutôt que sur l’avenir.
6. Indulgence vs Restriction
C’est le degré de liberté accordé à la satisfaction des désirs humains liés au plaisir et aux loisirs.
Dans une société marquée par l’indulgence, les individus expriment librement leurs sentiments et leurs désirs. Ils valorisent le temps libre, le divertissement et le plaisir personnel. Leurs interactions apparaissent plus détendues et spontanées, avec une tolérance accrue pour les comportements non conventionnels. La société encourage les personnes à satisfaire leurs envies et à profiter de la vie. Les normes sociales se montrent moins strictes et respectent davantage la liberté individuelle.
Dans une société marquée par la restriction, les individus limitent et encadrent l’expression de leurs sentiments et de leurs désirs par des normes strictes. Ils considèrent les loisirs et le plaisir personnel comme secondaires, tandis que la discipline et le devoir priment. Leurs interactions restent codifiées, et ils privilégient le respect des règles et de l’autorité. Ils retardent souvent la gratification immédiate, car la société impose des limites fermes aux comportements impulsifs. Les normes sociales se révèlent rigides, et la liberté individuelle demeure plus restreinte.
Pour conclure, ces dimensions vous permettent de mieux percevoir comment une société peut agir ou fonctionner et de moins vous sentir comme un extraterrestre venu d’une autre planète. Chaque culture a sa propre manière de fonctionner socialement parlant. D’ailleurs elle peut avoir des caractéristiques de deux polarités d’une dimension.
Edward T. Hall – Le principe de proxémie et la communication à haut et bas contexte
Edward T. Hall était un anthropologue américain qui a étudié comment la culture affecte notre communication. Il a développé les notions de proxémie (la distance entre les personnes) et de communication à haut et bas contexte, pour expliquer pourquoi certaines interactions varient selon les cultures.
La proxémie et la distance interpersonnelle
La proxémie, c’est la distance physique entre deux personnes en fonction des contextes.
1. La zone intime. (0-45 cm). C’est la distance auquel un individu se tiendra avec sa famille proche et son partenaire amoureux. Dans d’autres cultures, ce peut aussi être réservé à d’autres personnes.
2. La zone personnelle (45 cm – 1.2 m). C’est la distance auquel un individu se tiendra auprès de ses amis, ses collègues proches. C’est en fait la distance confortable pour une discussion informelle.
3. La zone sociale (1.2 – 3.5 m). C’est la distance auquel un individu se tiendra lors d’interactions professionnelles ou formelles. Par exemple, c’est la distance que l’on tient lors de réunion ou quand une personne échange avec un inconnu.
4. La zone publique (+3.5 m). C’est la distance auquel un individu se tiendra lors de conférences, de discours, d’interactions impersonnelles, d’interactions impersonnelles, d’interactions avec la foule.
Ces distances ne sont pas les mêmes pour tout le monde : elles varient selon les cultures, mais aussi selon la situation et les personnes en présence. En revanche, chaque individu a tendance à se tenir à des distances différentes en fonction des contextes peu importe la culture, en fonction de sa personnalité.
De plus, il peut y avoir d’autres types de contexte que celui que je viens de vous présenter où la distance entre les personnes dépend du contexte et du degré de proximité affective. Dans certaines cultures on va varier sa distance en fonction de si l’on parle avec une personne de même sexe que nous ou non, en fonction de l’âge de la personne, de sa position sociale (le patron et l’employé vs deux patrons vs deux employés par exemple), etc.
Quand les distances sociales ne sont pas respectées, cela peut créer un malaise ou sembler intrusif. Parfois, cela provoque des situations amusantes où l’un se rapproche trop et l’autre s’éloigne. Chacun a ses habitudes et son confort, et ajuste naturellement sa distance. Ces différences montrent que la proxémie varie selon les individus et les contextes.
Communication à haut et bas contexte
Dans une culture à haut contexte, beaucoup d’informations ne sont pas dites directement. La communication repose sur le contexte, le non-verbal, et la relation entre les personnes. Les sous-entendus, les gestes ou le ton de voix jouent un rôle important pour comprendre le message. Ces cultures mettent souvent l’accent sur la relation et l’harmonie plutôt que sur la clarté explicite.
Dans une culture à bas contexte, les informations sont exprimées de manière claire et directe. Les mots précis et détaillés pour que le message soit compris sans ambiguïté. Le non-verbal et les règles implicites jouent un rôle limité. Ces cultures privilégient la clarté et l’efficacité dans la communication, parfois plus que les nuances relationnelles.
Conclusion
Explorer les dimensions culturelles, la proxémie et le haut/bas contexte nous aide à mieux comprendre pourquoi les comportements, les interactions et les attentes sociales peuvent varier d’une culture à l’autre. Il ne s’agit pas de juger ces différences comme bonnes ou mauvaises, mais de reconnaître qu’elles reflètent des manières de fonctionner distinctes et cohéretes à l’intérieur de chaque société.
En développant cette compréhension, nous gagnons en ouverture d’esprit et en flexibilité : nous pouvons adapter nos comportements, communiquer plus efficacement et créer des relations plus harmonieuses, qu’il s’agisse de la vie quotidienne, du travail ou des échanges internationaux. Les différences culturelles deviennent alors une richesse plutôt qu’un obstacle, et apprendre à les décoder nous permet de mieux naviguer dans un monde globalisé, avec curiosité et respect.
Si vous sentez parfois des blocages dans vos échanges ou dans votre adaptation à certaines situations, mes accompagnements sont ouverts pour vous offrir un espace sécurisant et bienveillant. L’objectif est de vous permettre de mieux comprendre ces moments et de retrouver plus de légèreté et d’aisance dans vos interactions.
10 moyens simples pour apaiser l’anxiété et surmonter une crise de panique
Il arrive parfois que, sans prévenir, votre corps et votre esprit se mettent en état d'alerte maximale : votre cœur s'emballe, vous avez du mal à respirer, des étourdissements, des tremblements, et une sensation de malaise intense. Tout semble s'emballer, même si vous...
Le choc culturel : comprendre, reconnaître et gérer
Vos valises sont-elles prêtes pour partir à l'aventure ? Peut-être êtes-vous déjà installé dans votre nouveau pays, prêt à découvrir une nouvelle culture, un nouveau mode de vie. Pourtant, il est normal de ressentir une certaine appréhension face à ce changement. Vous...
Comment bien vivre son expatriation ?
L'expatriation est une aventure qui n'est pas toujours simple, et une aventure qui n'est pas toujours voulue non plus d'ailleurs. Quitter son cocon bien douillet pour aller se confronter à un monde qu'on ne connaît pas demande courage et audace. Lorsqu'elle est...